LA POURSUITE POUR DETTES ET FAILLITE EN DROIT SUISSE
Dernière mise à jour : novembre 2025
Table des matières
I. Remarques préliminaires sur la poursuite pour dettes en Suisse
III. La procédure préalable de poursuite
IV. La faillite du débiteur ou la saisie de ses biens
A) La poursuite par voie de faillite
C) La poursuite par voie de saisie
D) La nouvelle future procédure d’assainissement des dettes
I. Remarques préliminaires sur la poursuite pour dettes en Suisse
En droit suisse, la procédure de recouvrement de créances est régie par la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) du 11 avril 1889 (RS 281.1).
Le recouvrement de toute autre prétention est réglé par le titre 10 du Code de procédure civile fédéral (CPC) du 19 décembre 2008 (RS 272).
La procédure est la même pour toute la Suisse même si la langue peut être différente selon les cantons.
La particularité de la poursuite pour dettes en droit suisse réside dans le fait que l’exécution forcée est possible sur la base de simples affirmations du créancier et sans présentation d’aucun titre.
Ainsi, le prétendu créancier n’a pas besoin de posséder un titre exécutoire en particulier pour démarrer une procédure de recouvrement (jugement civil, sentence arbitrale, décision administrative, reconnaissance de dette signée de la main du débiteur ou résultant d’un acte authentique, etc.).
Inversement, même s’il bénéficie d’un titre incontestable, le créancier d’une somme d’argent est obligé de suivre la voie préalable de la poursuite pour dettes, car le seul titre exécutoire permettant d’obtenir la saisie ou la faillite du débiteur est la possession d’un commandement de payer en force, à l’exclusion de tout autre document (sauf exceptions).
La conséquence de cette particularité est que le débiteur peut immédiatement paralyser la poursuite engagée par le créancier en faisant opposition au commandement de payer. Le créancier devra alors faire lever cette opposition pour pouvoir continuer la poursuite engagée.
L’exécution forcée est une tâche étatique que l’on peut rapprocher de la fonction de police à certains égards.
La Suisse dispose d’un système très complexe de répartition des compétences en droit de l’exécution forcée.
En règle générale, la poursuite incombe à des autorités administratives spécialisées, à savoir les autorités de poursuites et de faillites de chaque canton qui se composent de l’Office des poursuites et de l’Office des faillites. Les décisions de ces autorités peuvent faire l’objet d’une plainte à l’autorité de surveillance (art. 17 LP).
Toutefois, dans certains cas, le droit de l’exécution forcée n’est pas appliqué par les autorités administratives mais par les tribunaux civils.
A cet égard, il convient de distinguer trois situations :
- Le juge se substitue parfois aux autorités administratives parce que la décision à rendre est particulièrement importante et entraîne des conséquences lourdes pour les parties. Le juge civil ne rend pas un jugement mais une décision, il agit en qualité d’organe de la poursuite. Tel est par exemple le cas du prononcé de la faillite. La compétence du juge est ici impérative (fondée sur le droit national suisse) et il ne peut y être dérogé par les parties.
- Le juge suisse peut être chargé de trancher des incidents de poursuites. Ici le juge suisse intervient parce qu’une partie s’oppose à la continuation de la poursuite en soulevant un incident. Certaines décisions relèvent du pur droit des poursuites (par exemple la mainlevée définitive de l’opposition) et d’autres du droit matériel des poursuites (par exemple la mainlevée provisoire de l’opposition). La compétence du juge est également impérative et fondée sur le droit national suisse, sous réserves des accords internationaux contraires (par exemple la Convention de Lugano concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale du 30 septembre 2007 (RS 0.275.12)).
- Le juge est enfin appelé à trancher des contestations de droit matériel portant sur la validité des créances. Ces incidents ne concernent pas le droit de l’exécution forcée, mais sont simplement soulevés à l’occasion d’une poursuite en cours pour trancher un litige de droit matériel. Jusqu’à droit connu, la poursuite ne peut être continuée en raison de l’incertitude régnant à cet égard. Il s’agit d’une procédure ordinaire soumise au droit ordinaire. Les cas d’application les plus importants sont l’action en reconnaissance de dette (art. 79 LP) et l’action en libération de dette (art. 83 LP). Pour déterminer la compétence du juge il convient de se référer à la volonté des parties (élection de for par exemple) ainsi qu’au droit international et national applicable au litige.
Ces distinctions, parfois complexes, ont des conséquences au niveau des fors et sur les effets des décisions.
Ainsi, les procédures relevant uniquement du droit matériel doivent être introduites aux fors prévus par le droit commun. Par exemple, si les parties à un contrat ont convenu une clause compromissoire, le juge étatique suisse ne sera pas compétent pour déterminer si la créance est valable sur le fond. La sentence arbitral revêtira l’autorité de la chose jugée et sera contraignante pour le juge et les autorités administratives de poursuites en Suisse.
En revanche, les procédures qui soulèvent des questions de droit de l’exécution forcée doivent être introduites aux fors prévus par le droit impératif suisse. Ainsi, un tribunal arbitral par exemple ne pourra pas trancher une demande de mainlevée définitive ou de mainlevée provisoire quand bien même il y aurait une clause compromissoire dans le contrat. Ces décisions auront un effet définitif sur la poursuite en cours uniquement.
La procédure de recouvrement est normalement introduite par la procédure préalable.
Celle-ci est la phase de la procédure située entre la réquisition de poursuite (art. 67 LP) et la réquisition de continuer la poursuite (art. 88 LP).
Les principes directeurs de cette phase sont au nombre de deux, étant précisé que c’est l’Office des poursuites qui effectue les actes de poursuites et que le créancier ne peut y procéder ni les notifier lui-même :
- Le fardeau de l’initiative : La procédure n’avance pas d’office, mais nécessite, à chaque étape, une action du créancier. Cette action se limite, dans un premier temps, à une simple déclaration de volonté adressée à l’Office des poursuites.
- Le fardeau de la réaction : Le débiteur peut bloquer la procédure par une opposition. Elle se limite à son tour à une simple déclaration de volonté qui obligera le créancier à démontrer devant le juge étatique ou un tribunal arbitral le bien-fondé de sa prétention. Si le débiteur n’agit pas, la procédure suit son cours par le seul écoulement du temps.
*****
Avant de détailler les étapes de la procédure, il convient de mentionner trois éléments importants :
En premier lieu, la poursuite est généralement toujours intentée au lieu de domicile ou du siège du débiteur. C’est ce que l’on appelle le for de la poursuite (art. 46ss LP). Comme mentionné précédemment, ce for doit être distingué du for judiciaire qui détermine le juge compétent pour les décisions judiciaires. Il convient dès lors de porter une attention particulière à ce point et de déterminer avec précision quelle action doit être intentée et dans quel endroit.
En second lieu, il est impératif que le créancier domicilié à l’étranger fasse élection de domicile auprès d’un mandataire professionnel établi en Suisse. A défaut d’élection de domicile en Suisse, les actes sont réputés notifiés au siège de l’Office des poursuites ce qui peut avoir des conséquences sur les délais. En effet, chaque acte de poursuite doit être introduit dans un délai précis sinon la procédure devient caduque.
Enfin, il appartient au créancier poursuivant d’avancer les frais de tout acte de poursuite. Les frais de poursuites sont déterminés par l’Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) du 23 septembre 1996 (RS 281.35).
L’émolument pour la rédaction d’un commandement de payer dépend du montant de la créance : Il est par exemple de CHF 90 pour une créance comprise entre CHF 10’000 et CHF 100’000 et de CHF 190 pour une créance comprise entre CHF 100’001 et 1’000’000 (art. 16 OELP). L’émolument pour chaque tentative de notification est de CHF 7. Au besoin, la police peut être mandatée pour notifier le commandement de payer à un débiteur cherchant à se soustraire à la poursuite, ce qui engendre des frais supplémentaires. En dernier recours, la notification peut se faire par publication dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) et dans les feuilles d’avis officielles cantonales (FAO).
S’agissant de la procédure de mainlevée de l’opposition, le tarif d’avance des frais est de CHF 50 à CHF 300 pour une valeur litigieuse comprise entre CHF 1’000 et CHF 10’000, de CHF 60 à CHF 500 pour une valeur litigieuse comprise entre CHF 10’001 et CHF 100’000, de CHF 70 à CHF 2’000 pour une valeur litigieuse comprise entre CHF 100’001 et CHF 1’000’000 et de CHF 500 à CHF 4’000 pour une valeur litigieuse supérieure (art. 48 OELP).
Les frais avancés par le créancier poursuivant s’ajoutent à la créance. Ils sont remboursés au créancier lors de la distribution des deniers.
*****
La procédure de recouvrement proprement dite est introduite par l’envoi d’une réquisition de poursuite à l’Office des poursuites du canton de domicile du débiteur (généralement par le biais d’un formulaire envoyé par le créancier) (art. 46ss LP).
Cette réquisition de poursuite doit comporter un certain nombre d’indications comme le nom et l’adresse du débiteur, le montant et la cause de la créance ainsi que les intérêts dus. Le montant de la créance doit être indiqué en francs suisses même si celle-ci est stipulée en monnaie étrangère (art. 67 al. 1 ch. 3 LP).
A noter que l’Office des poursuites n’examine pas le bien-fondé de la créance alléguée par le créancier, seul le juge étatique ou un tribunal arbitral dispose de cette prérogative.
L’envoi d’une réquisition de poursuite a un double effet :
- D’une part, elle contraint l’Office des poursuites à inscrire la créance dans le Registre des poursuites (art. 8 LP), registre qui est public. En cas de faillite du débiteur (par exemple s’il fait l’objet de plusieurs poursuites antérieures), le créancier sera immédiatement informé et partie à la procédure de liquidation (art. 233 LP).
- Elle permet d’interrompre la prescription de la créance (art. 135 du Code des obligations suisse (CO) du 30 mars 1911 (RS 220). Une fois que l’inscription est faite, chaque acte de poursuite entrepris par l’Office des poursuites ou les parties renouvelle l’interruption (art. 138 al. 2 CO).
A noter que l’envoi d’une réquisition de poursuite ne constitue pas une atteinte illicite à la personnalité du débiteur dans la mesure où elle est justifiée par la loi ainsi que par l’intérêt prépondérant du créancier (art. 28 du Code civil suisse (CC) du 10 décembre 1907 (RS 210). L’abus de droit par le créancier est réservé notamment si le but de la poursuite est de détruire la bonne réputation du débiteur et si celle-ci est manifestement infondée (voir ci-dessous sous V).
L’Office des poursuites fera ensuite notifier un commandement de payer au débiteur lui sommant de payer la somme mentionnée dans la réquisition de poursuite dans les 20 jours (art. 69 LP).
Le délai pour notifier le commandement de payer varie selon les cantons mais est généralement d’un ou deux mois.
En règle générale, le procès au fond est mené en parallèle avec le début de la procédure de recouvrement afin que le créancier n’ait pas à attendre la notification du commandement de payer à l’issue du jugement constatant l’existence de la créance.
Le débiteur dispose de trois possibilités : soit il paie la somme due dans le délai et la poursuite est suspendue puis radiée à la demande du créancier ; soit il ne fait rien et le créancier pourra alors requérir la continuation de la poursuite après un délai d’attente de 20 jours (art. 88 LP) ; soit enfin, le débiteur fait opposition au commandement de payer dans les 10 jours.
Attention, lorsqu’une réquisition de poursuite est déposée et qu’un commandement de payer est notifié au débiteur, celui-ci ne peut s’acquitter de sa dette qu’auprès de l’Office des poursuites, sous peine de devoir payer deux fois (ATF 114 III 49). En effet, le paiement effectué directement entre les mains du créancier n’interrompt pas la procédure de poursuite.
L’absence d’opposition ne signifie toutefois pas que le débiteur reconnaisse la dette.
Si le débiteur fait opposition au commandement de payer (aucune forme particulière n’est requise ni aucune motivation, elle peut être totale ou partielle), le créancier doit obtenir du juge la mainlevée de l’opposition.
Si le créancier n’introduit pas cette procédure dans un délai d’une année dès la notification commandement de payer la poursuite se périme (art. 88 LP).
Le créancier peut obtenir la levée de l’opposition du débiteur par trois voies légales :
- Si le créancier est au bénéfice d’un jugement définitif condamnatoire (suisse ou étranger), ou un titre qui y est assimilé comme une sentence arbitrale finale, une décision des autorités administratives suisses en force (comme un avis de taxation), ou encore une transaction passée en justice (telles qu’une convention de divorce), il peut introduire une requête en mainlevée définitive au for de la poursuite (art. 80 LP). Cette procédure est extrêmement simple et rapide et permet de continuer la poursuite dans des délais très brefs. Les objections du débiteur sont en effet très limitées, il doit prouver par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou que la prescription est acquise (arrêt du Tribunal fédéral 4A_637/2023 du 4 décembre 2024). Si le jugement ou la sentence arbitrale a été rendu à l’étranger, une procédure d’exéquatur préalable est nécessaire afin de faire reconnaitre le jugement en Suisse.
- Si le créancier est au bénéficie d’une reconnaissance de dette, il peut requérir la mainlevée provisoire de la poursuite auprès du juge du for de la poursuite (art. 82 LP). Il s’agit là aussi d’une procédure simplifiée et les objections du débiteur sont limitées. Les chances de succès sont plus incertaines que dans le cas d’une mainlevée définitive car elles dépendent des documents présentés et de l’appréciation du juge.
La notion de reconnaissance de dette n’est pas spécifiée dans la loi. Il peut soit s’agir d’un document formel, soit d’une combinaison de documents. La jurisprudence a défini la reconnaissance de dette comme l’acte sous seing privé ou authentique, signé par le poursuivi, ou son représentant, d’où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (arrêt du Tribunal fédéral 4A_676/2024 du 9 juillet 2025).
A cet égard, il a notamment été jugé qu’un relevé de compte émanant d’une banque constituait une reconnaissance de dette.
Le fait que le titre ait été rédigé par le poursuivant (ou son représentant) est dénué de pertinence ; il suffit qu’il comporte la signature du poursuivi ou de son représentant. Une facture signée sans réserve ni conditions par le débiteur remplit les conditions de l’article 82 al. 1 LP, sans qu’il importe que la mention « pour accord » figure à côté de la signature (arrêt du Tribunal fédéral 5A_439/2023 du 23 novembre 2023).
D’une manière générale, un contrat bilatéral (contrat de vente, bail, travail, mandat, etc.) peut être considéré comme une reconnaissance de dette à certaines conditions (ATF 145 III 20). Ainsi, un contrat signé par les parties et indiquant le montant dû par le débiteur vaut titre de mainlevée provisoire, si le créancier peut prouver par titre (i) qu’il a exécuté ses obligations découlant du contrat (ii) que la prestation du débiteur est exigible, et (iii) que les éventuelles conditions suspensives affectant le contrat sont réalisées. Certains contrats spécifiques nécessitent que d’autres conditions soient réunies.
Lorsqu’il procède à l’interprétation de la reconnaissance de dette, le juge de la mainlevée provisoire ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques à ce titre, à l’exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d’examen. Si le sens ou l’interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes, la mainlevée provisoire sera refusée. La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces, dont le but n’est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l’existence d’un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante de la reconnaissance de dette produite par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance – et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires. En effet, conformément à l’article 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections – qui infirment la reconnaissance de dette, par exemple un vice de forme qui affecte son obligation. Une allégation est rendue vraisemblable lorsque le juge a l’impression, sur la base d’éléments objectifs, qu’un état de fait est exact tel qu’il a été décrit ; cela n’exclut pas une autre possibilité. En revanche, le juge n’a pas besoin d’être convaincu que les faits se déroulent effectivement comme ils ont été présentés.
La procédure de mainlevée, qu’elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d’exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d’un procès ordinaire. En d’autres termes, le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites et ne fonde pas l’exception de chose jugée quant à l’existence de la créance. La décision du juge de mainlevée ne prive donc pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (art. 83 al. 2 LP).
Si la mainlevée provisoire est accordée, le débiteur doit dans les 20 jours intenter une action en libération de dette au for de la poursuite ou au for judiciaire. Il s’agit d’une action judiciaire, soumise à la procédure ordinaire (art. 219 ss CPC) ou, si la valeur litigieuse ne dépasse pas CHF 30’000.-, à la procédure simplifiée (art. 243 al. 1 CPC).
L’action en libération de dette de l’article 83 al. 2 LP est une action en constatation de droit négative, qui a pour but de faire constater l’inexistence ou l’inexigibilité de la créance déduite en poursuite. Elle ressortit au droit matériel et la décision est revêtue cette fois de l’autorité de la chose jugée.
Il se produit ainsi un renversement du fardeau de la preuve. Il appartient maintenant au débiteur de prendre les devants et de prouver que la dette n’existe pas.
L’action en libération de dette peut également être introduite devant un Tribunal arbitral, si une clause compromissoire a été conclue par les parties.
Attention, le délai de 20 jours pour intenter une action en libération de dette commence dès la notification du dispositif de mainlevée provisoire au débiteur, et non à partir de la notification de la décision motivée (ATF 150 III 400).
A défaut d’action en libération de dette, la mainlevée provisoire devient définitive (art. 83 LP), permettant au créancier de requérir la continuation de la poursuite (art. 88 LP).
Si le juge prononce la libération de la dette du débiteur, la poursuite s’interrompt et toute nouvelle poursuite devient impossible pour la même créance (res judicata).
Si le juge rejette la demande du débiteur, le créancier peut demander la continuation de la poursuite (art. 88 LP) et le jugement à valeur de titre de mainlevée définitive.
Il ne reste alors qu’au débiteur que des moyens d’actions limités pour échapper à son créancier comme l’action en annulation de la poursuite en procédure sommaire, s’il prouve par titre que la dette est éteinte en capital, intérêts et frais, ou celle en suspension de la poursuite, s’il prouve par titre que le créancier lui a accordé un sursis (art. 85 LP). Il peut encore dans certains cas (par exemple si l’action en libération de dette a été déclarée irrecevable pour non-respect du délai de 20 jours de l’art. 83 al. 2 LP) ouvrir action en annulation de la poursuite en procédure ordinaire ou simplifiée (art. 85a LP).
- Enfin, si le créancier n’est au bénéfice d’aucun titre de mainlevée (définitif ou provisoire), il doit intenter une action en reconnaissance de dette par devant le juge du for judiciaire. La procédure ordinaire est applicable. Si la créance relève d’une juridiction spéciale (prud’hommes, baux et loyers, droit maritime, tribunal arbitral), c’est devant cette juridiction que cette action doit être portée. Une fois que le jugement sur le fond est rendu, il convient de le faire reconnaître en Suisse (procédure d’exequatur s’il s’agit d’un jugement étranger) et d’introduire une requête en mainlevée définitive (la procédure de mainlevée et d’exequatur font l’objet d’une seule et même requête).
Après la phase de mainlevée, la poursuite ne continue que si le créancier en fait la réquisition.
Il peut requérir la continuation de la poursuite à l’Office des poursuites lorsque :
1) Le commandement de payer n’a pas fait l’objet d’opposition ;
2) Le créancier a obtenu la mainlevée définitive de l’opposition (voie 1) ;
3) Le créancier a obtenu la mainlevée provisoire de l’opposition et le débiteur n’a pas introduit d’action en libération de dette (voie 2) ;
4) Le débiteur a été débouté de sa demande de libération de dette (voie 2) ;
5) Le créancier a fait reconnaître la créance au terme de l’action en reconnaissance de dette (voie 3).
Le créancier peut à nouveau convertir la créance stipulée en monnaie étrangère en francs suisses et ainsi ajuster le taux de change.
La réquisition de continuer la poursuite contraint l’Office des poursuites à faire notifier au débiteur une commination de faillite (art 159 LP) ou un avis de saisie (art. 90 LP).
La réquisition de continuer la poursuite met ainsi un terme à la procédure préalable et ouvre la voie de la faillite ou de la saisie selon que le débiteur est inscrit au Registre du commerce ou non (art. 39 ss LP).
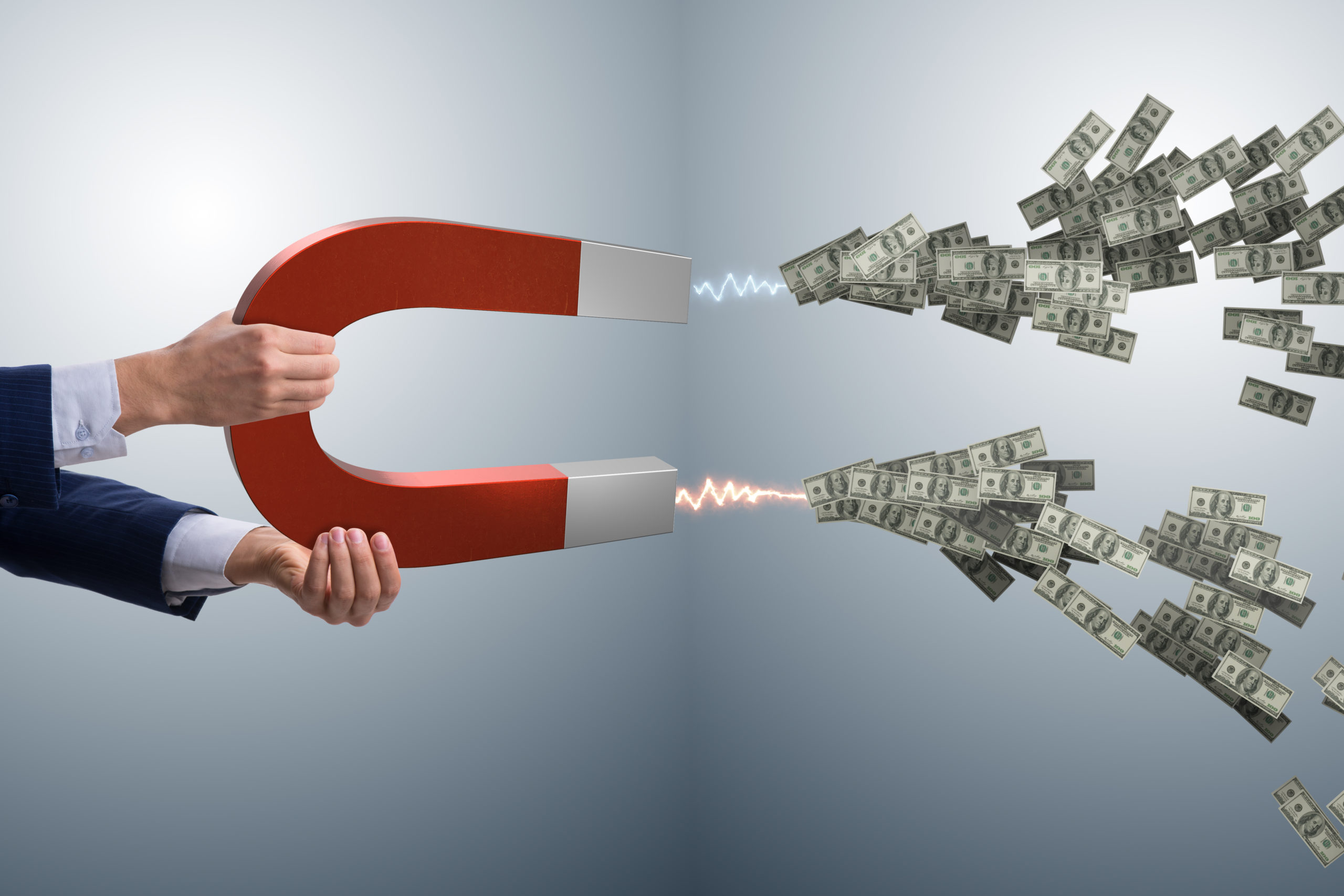
IV. La faillite du débiteur ou la saisie de ses biens
Dans la poursuite pour dettes, les types de recouvrement diffèrent : les personnes morales (société anonyme, société à responsabilité limitée, association, fondation, etc.), les propriétaires d’une entreprise individuelle et les organes à responsabilité illimitée (associé dans une société en nom collectif, associé indéfiniment responsable dans une société en commandite, etc.) inscrits au registre du commerce sont assujettis à la poursuite par voie de faillite, tous les autres débiteurs à la poursuite par voie de saisie.
A) La poursuite par voie de faillite
La faillite d’une entreprise est généralement requise par le créancier, selon la procédure préalable détaillée ci-dessus. Mais le conseil d’administration d’une société, voire le réviseur peut également avoir l’obligation d’informer le juge en cas de surendettement, à savoir lorsque la valeur des biens de l’entreprise, son actif, ne couvre plus le montant de ses dettes (voir notre page sur la constitution d’une entreprise en Suisse pour plus de détails). D’autres cas de faillites existent comme par exemple lorsque la société ne possède plus tous les organes prescrits dans la loi ou que l’un de ces organes n’est pas composé conformément aux prescriptions légales (art. 731b CO).
Du côté du créancier, suite à la réquisition de continuer la poursuite, l’Office fait parvenir au débiteur soumis à la faillite une commination de faillite l’informant que s’il ne paie pas dans un ultime délai de 20 jours, le créancier pourra requérir du juge la mise en faillite de la société au for de la poursuite.
Donnant suite à la requête du créancier, le tribunal compétent prononce un jugement de faillite.
Le jugement est communiqué à l’Office des faillites, publié dans la FOSC et notifié aux créanciers connus, déclenchant les délais légaux pour la production des créances. Dès ce moment, le débiteur est dessaisi de ses biens – qui forment désormais la masse en faillite –, ne peut plus en disposer, et toutes les poursuites individuelles sont suspendues. Les créances non échues deviennent exigibles, et les intérêts cessent de courir sur celles non garanties par gage.
L’Office des faillites gère l’ensemble de la procédure : il dresse un inventaire des actifs et passifs, scelle les biens, vérifie les droits de tiers et évalue les valeurs de liquidation des actifs. Une première assemblée des créanciers est ensuite convoquée afin de déterminer le mode de liquidation – ordinaire ou sommaire –, de désigner éventuellement une administration spéciale et de fixer les premières orientations relatives à la réalisation des actifs. Pendant toute la procédure, l’administration peut gérer les affaires courantes, poursuivre temporairement l’exploitation d’une entreprise ou résilier les contrats en cours.
Toutes les faillites en Suisse comportent une phase de liquidation, décrite aux articles 221ss LP. Deux types de procédures existent principalement : la liquidation sommaire et la liquidation ordinaire, qui doivent, en principe, être achevées dans un délai d’un an après l’ouverture de la faillite.
La liquidation sommaire, la plus courante, s’applique aux cas simples ou lorsque la société ne dispose plus d’actifs importants. Elle est proposée par l’Office des faillites au juge et permet un traitement rapide et efficace. L’Office des faillites procède à l’inventaire du patrimoine, publie un appel aux créanciers leur enjoignant de produire leurs créances dans un délai généralement fixé à un mois, puis établit un état de collocation recensant et classant les créances admises selon leur rang légal.
L’état de collocation établi par l’Office des faillites classe en effet les créances selon leur rang de priorité défini par la loi :
- Premier rang : créances des travailleurs pour les salaires des six derniers mois, créances d’entretien du droit de la famille et certaines créances d’assurances sociales.
- Deuxième rang : cotisations sociales non comprises dans le premier rang, primes d’assurance obligatoire et autres créances privilégiées.
- Troisième rang : toutes les autres créances chirographaires, non garanties.
Les créances garanties par gage sont traitées séparément et bénéficient d’un droit préférentiel sur le produit de la réalisation du bien gagé. À l’intérieur d’un même rang, la distribution s’effectue au marc le franc, c’est-à-dire proportionnellement à la part de chaque créance.
Les actifs sont ensuite réalisés (vente aux enchères ou de gré à gré), et le produit est distribué selon l’ordre des priorités, après paiement des frais de la faillite. Les créanciers non entièrement désintéressés reçoivent un acte de défaut de biens, et la clôture fait l’objet d’un jugement publié entraînant la radiation de la société du registre du commerce.
La liquidation ordinaire, plus rare, concerne les faillites d’importance. Elle comprend deux assemblées des créanciers, qui assurent un contrôle accru de la procédure. Ces assemblées décident notamment de la poursuite éventuelle de l’activité, des ventes de gré à gré, de la nomination d’une administration spéciale ou encore de la constitution d’une commission de surveillance. Ce mode de liquidation vise une transparence renforcée et une participation active des créanciers à la gestion de la faillite.
Le droit suisse prévoit également des procédures spéciales pour certaines entités (banques, compagnies d’assurance) placées sous surveillance fédérale, ainsi que des mécanismes alternatifs tels que le sursis concordataire, permettant de conclure un accord avec les créanciers avant ou après la faillite. Des mesures préventives, comme l’ajournement de la faillite ou la restructuration amiable des dettes, permettent enfin d’éviter la liquidation lorsqu’un assainissement reste possible.
B) La faillite personnelle
En Suisse, toute personne surendettée, qu’elle soit inscrite au registre du commerce ou non, peut déclarer son insolvabilité auprès du juge compétent conformément à l’article 191 LP. Lorsque toute possibilité d’arrangement amiable avec les créanciers est exclue, le juge peut ouvrir une procédure de faillite personnelle. Celle-ci entraîne la liquidation de l’ensemble des biens saisissables du débiteur, y compris, le cas échéant, son logement, afin de désintéresser partiellement les créanciers.
La faillite personnelle a pour effet immédiat de suspendre toutes les poursuites et saisies en cours, notamment celles portant sur le salaire. Elle offre ainsi au débiteur une protection juridique renforcée et un répit financier temporaire, lui permettant de rétablir un équilibre budgétaire. Toutefois, elle n’efface pas les dettes, les personnes physiques peuvent toujours être poursuivies : les créanciers reçoivent un acte de défaut de biens, leur permettant de réclamer ultérieurement le solde dû si la situation du débiteur s’améliore. La créance constatée par cet acte se prescrit par 20 ans (art. 149a al. 1 LP).
Pour que la faillite personnelle soit prononcée, plusieurs conditions cumulatives doivent être remplies :
- le débiteur doit prouver son surendettement effectif ;
- il doit démontrer que toute possibilité de règlement amiable des dettes selon les articles 333ss LP est exclue ;
- il doit présenter un budget équilibré pour l’avenir, garantissant qu’il pourra assumer ses charges courantes, notamment fiscales, sans contracter de nouvelles dettes ;
- enfin, il doit verser une avance de frais d’environ CHF 4’000.-, couvrant les coûts de procédure, les interventions de l’office des faillites et les publications officielles dans la FOSC et les feuilles d’avis officielles cantonales.
La faillite personnelle ne constitue donc pas un mécanisme de désendettement, mais bien une procédure exceptionnelle de redressement, permettant au débiteur honnête mais accablé de repartir sur des bases financières assainies, sous la protection du cadre légal. Elle demeure toutefois de moins en moins acceptée par les tribunaux.
En effet, en vertu de l’article 230 al. 1 LP, lorsqu’il est probable que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation sommaire, le juge qui a ordonné la faillite prononce la suspension de celle-ci à la demande de l’Office des faillites. Dans ce cas, la faillite est close, sans délivrance d’actes de défaut de biens, avec pour conséquence non seulement que les poursuites renaissent (art. 230 al. 4 LP) et sont continuées par voie de saisie, mais que le débiteur ne pourra pas exciper de son défaut de retour à meilleure fortune conformément à l’article 265 LP.
Par ailleurs, selon le Tribunal fédéral (ATF 133 III 614), « l’article 191 LP demeure une procédure d’insolvabilité, dont le but est de répartir les biens du débiteur de manière équitable entre tous les créanciers. Celui qui requiert volontairement sa faillite doit donc avoir quelques biens à abandonner à ses créanciers. Certes, le débiteur en tire une certaine protection puisqu’il peut opposer son défaut de retour à meilleure fortune, retrouvant la possibilité de mener un train de vie conforme à sa situation sans être réduit au minimum vital. Mais, par cet article 191 LP, le législateur n’a pas voulu introduire et n’a pas introduit une procédure de désendettement des particuliers, pour régler le problème du surendettement des débiteurs les plus obérés, qui n’ont plus d’actifs et n’ont même pas les moyens d’avancer les frais de la procédure. »
Le Tribunal fédéral a ainsi jugé abusive, d’une part, la demande de faillite personnelle présentée par un débiteur ne disposant plus d’actifs à répartir entre les créanciers (arrêts du Tribunal fédéral 5A_915/2014 du 14 janvier 2015 et 5A_78/2016 du 14 mars 2016), et, d’autre part, la manœuvre visant à faire cesser une saisie de revenus au profit du seul créancier poursuivant, même lorsque le débiteur conservait certains biens (ATF 145 III 26).
La voie de la faillite personnelle reste donc très restreinte.
C) La poursuite par voie de saisie
Si le débiteur est poursuivi par la voie de la saisie, l’Office des poursuites adresse au poursuivi un avis de saisie, lequel indique le jour et l’endroit de la saisie.
Le poursuivi est tenu d’assister à la saisie ou de s’y faire représenter et d’indiquer tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession (par exemple en prêt chez quelqu’un).
Tous les revenus du débiteur peuvent être saisis (par exemple le salaire), de même que ses biens, déduction faite de ce que l’Office des poursuites estime indispensable au débiteur et à sa famille.
Pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite (minimum vital), l’Office des poursuites se réfère aux normes d’insaisissabilités éditées par les cantons (voir par exemple à Genève).
Certains actifs, tels que les articles ménagers indispensables, les animaux domestiques, les objets de culte, les outils professionnels, les pensions AVS et AI, les prestations complémentaires et les avoirs non échus de la prévoyance professionnelle, ne peuvent généralement pas faire l’objet d’une saisie (art. 92 LP).
Après la saisie des biens, le créancier peut requérir leur réalisation en adressant à l’Office des poursuites une réquisition de vente en respectant les délais fixés à l’article 116 al. 1 LP, soit :
– un mois au plus tôt et un an au plus tard s’il s’agit de biens meubles ;
– six mois au plus tôt et deux ans au plus tard s’il s’agit d’immeubles.
La réalisation est généralement effectuée par la vente aux enchères publiques. Les recettes seront réparties entre les créanciers saisissants après déduction des frais.
A noter que le jugement de mainlevée provisoire permet au créancier de requérir déjà la saisie provisoire ou l’inventaire (art. 83 al. 1 LP).
Si, à l’issue de la poursuite et de la saisie, le créancier n’a pas été intégralement désintéressé, il reçoit un acte de défaut de biens indiquant le montant de la créance restant à recouvrer.
L’acte de défaut de biens vaut reconnaissance de dette dans le cadre de la procédure de mainlevée de l’opposition.
Dès la délivrance de l’acte de défaut de biens, les intérêts cessent de courir. De plus, la créance constatée par un acte de défaut de biens se prescrit par 20 ans à compter de sa délivrance. Ce délai peut être interrompu, notamment, par de nouvelles poursuites ou reconnaissances de dette.
D) La nouvelle future procédure d’assainissement des dettes.
Un dispositif dit de « deuxième chance » est actuellement en discussion auprès du Parlement suisse. Celui-ci vise à offrir un souffle nouveau aux personnes en situation de surendettement en instaurant une procédure d’assainissement de dettes sur trois ans.
Selon le projet actuellement à l’étude, les débiteurs disposant d’un revenu régulier pourront accéder à une « procédure concordataire simplifiée » permettant une remise d’une partie des dettes du débiteur, si la majorité de ses créanciers l’approuve et que le juge l’estime appropriée. Cet accord sera contraignant pour tous les créanciers, même pour ceux qui n’y ont pas adhéré.
Les débiteurs sans espoir de trouver un accord avec leurs créanciers se verraient eux proposer une véritable voie de « faillite personnelle ». Le débiteur devra alors remettre dans un premier temps tous les fonds dont il dispose à ses créanciers et prouver qu’il fait des efforts pour toucher des revenus réguliers. Celui qui aura respecté tous ses engagements durant la première phase, bénéficiera d’une libération du solde de ses dettes. Mais attention, si la personne ainsi désendettée obtient des rentrées exceptionnelles d’argent durant un certain temps après la procédure, par exemple un héritage ou une donation, cet argent devra être ristourné aux créanciers.
Ce mécanisme entend répondre à la critique selon laquelle, à ce jour, le droit suisse des poursuites ne donne pas de voie de sortie aux ménages surendettés.
Comme il l’a été relevé ci-dessus, le droit suisse de l’exécution forcée présente la particularité de permettre à quiconque d’engager des poursuites sans qu’une autorité procède à un contrôle préalable de la créance.
Bien que rares, les poursuites malveillantes, chicanières ou manifestement abusives existent dans le seul but de porter au Registre des poursuites des créances inexistantes à la connaissance du public afin de ruiner la réputation économique du débiteur.
Aussi, quand bien même un commandement de payer serait périmé par l’écoulement du temps, les poursuites demeurent inscrites au Registre pendant un délai de 5 ans. Il en va de même lorsque celles-ci ont été soldées (la mention « payée » figurera alors sur le document), à moins que le créancier ne donne un contrordre de la poursuite.
Les poursuites abusives peuvent faire l’objet d’une plainte pénale pour contrainte au sens de l’article 181 du Code pénal suisse (CP) du 21 décembre 1937 (RS 311.0).
Dans le cadre de la révision du 16 décembre 2016 de l’article 8a de la LP (FF 2016 8631), le législateur a également créé un nouvel instrument qui permet aux victimes de poursuites injustifiées de s’opposer à ce que celles-ci soient portées à la connaissance du public, c’est-à-dire à ce qu’elles figurent sur l’extrait du Registre des poursuites.
Ainsi, les offices des poursuites ne doivent pas porter à la connaissance de tiers les poursuites pour lesquelles une demande du débiteur dans ce sens est faite à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du commandement de payer, à moins que le créancier ne prouve, dans un délai de 20 jours imparti par l’Office des poursuites, qu’une procédure d’annulation de l’opposition a été engagée à temps (mainlevée provisoire ou définitive de l’opposition ou action en reconnaissance de dette). Bien entendu, le débiteur doit préalablement avoir fait opposition totale à la poursuite. Afin de prouver qu’il a engagé une procédure visant à faire annuler l’opposition, le créancier peut fournir la confirmation de remise à la poste ou l’accusé de réception de la demande de mainlevée ou du mémoire introduisant l’action en reconnaissance de dette ; dans certains cantons, il peut fournir une facture (originaux ou copies de ces documents).
Lorsque la preuve est apportée par la suite qu’une demande est pendante, ou lorsque la poursuite est continuée, celle-ci est à nouveau portée à la connaissance de tiers.
A noter que si la demande du débiteur concerne une poursuite engagée plus de cinq ans auparavant, poursuite qui par conséquent n’apparaît plus au Registre, l’office compétent n’y donne pas suite, étant donné qu’il n’a pas un intérêt digne de protection.
Cette nouvelle disposition est entrée en vigueur le 1er janvier 2019.

VI. La problématique des faillites abusives
Avec plus de 17 000 faillites ouvertes chaque année en Suisse, dont près de 40 % sont suspendues faute d’actifs, une part importante des procédures n’est en réalité jamais menée à terme, faute de biens à réaliser pour couvrir les frais. Cette situation révèle les failles du dispositif actuel et les risques d’abus liés à une utilisation opportuniste de la faillite.
Depuis le 1er janvier 2025, de nouvelles dispositions ont été introduites pour empêcher le détournement de la procédure de faillite à des fins abusives. En effet, certains dirigeants profitaient de la faillite pour effacer leurs dettes, notamment fiscales, sociales ou salariales, avant de reconstituer une nouvelle société, souvent en rachetant à bas prix les actifs de la masse en faillite et en réembauchant leur ancien personnel. Ce procédé leur permettait de poursuivre la même activité sous une autre raison sociale, tout en bénéficiant d’un avantage concurrentiel indu.
De telles pratiques portent atteinte à la concurrence loyale et font supporter à la collectivité le coût des salaires impayés, souvent pris en charge par les caisses de chômage. Pour y remédier, les réformes récentes visent à prévenir et sanctionner ces comportements, en renforçant la transparence et la responsabilité des dirigeants et en coordonnant plus étroitement le droit des sociétés, le droit de la faillite et le droit pénal économique.
A) Modifications du Code des obligations
Plusieurs modifications importantes du Code des obligations (CO) du 30 mars 1911 (RS 220) renforcent la transparence en matière de droit des sociétés.
D’une part, la renonciation au contrôle restreint (opting-out) est désormais strictement encadrée. Jusqu’ici, les sociétés de moins de dix employés pouvaient, avec l’accord de tous les actionnaires, renoncer rétroactivement à la révision de leurs comptes. Désormais, la déclaration d’opting-out ne produit d’effet que pour l’avenir et doit être déposée avant le début de l’exercice concerné (art. 727a al. 2 et 2bis CO). Cette mesure vise à éviter que certaines entreprises dissimulent leurs difficultés financières, notamment vis-à-vis de leurs créanciers, par exemple lorsque l’organe de révision avait identifié des irrégularités ou avait émis des réserves dans son rapport, notamment en cas de surendettement au sens de l’article 725b CO. Les offices du registre du commerce peuvent en outre exiger le renouvellement de la déclaration lorsque l’administration fiscale signale l’absence de dépôt de comptes annuels, afin de garantir un suivi comptable minimal et la détection précoce d’un surendettement (art. 112 al. 4 de la Loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD) du 14 décembre 1990 (RS 642.11)).
D’autre part, le nouveau droit introduit les articles 684a et 787a CO, qui frappent de nullité le transfert de « manteaux d’actions », c’est-à-dire la vente d’une société juridiquement existante mais économiquement liquidée et surendettée. L’objectif est d’éviter la réutilisation abusive de sociétés vides pour contourner les règles de création ou de liquidation. En cas de soupçon fondé (notamment en cas de changement simultané du siège, du but ou du conseil d’administration), le registre du commerce peut exiger la production des comptes annuels et refuser ou radier l’inscription si les soupçons sont confirmés (art. 684a al. 2 et 3 CO et 934 CO).
Enfin, l’introduction de l’article 928b CO instaure la possibilité de rechercher une personne dans le registre du commerce. Cette base de données, accessible gratuitement en ligne, offre une vue d’ensemble de l’historique économique d’une personne : fonctions exercées, entités juridiques concernées et éventuelles procédures de faillite. Cette mesure vise à accroître la transparence et à faciliter le travail des autorités, notamment pour le prononcé d’interdictions d’exercer au sens de l’article 67 du Code pénal (CP) du 21 décembre 1937 (RS 311.0) (voir ci-dessous).
Pour de plus amples détails, nous vous invitons à consulter notre page dédiée à la création d’une entreprise en Suisse.
B) Modifications du droit de la poursuite et de la faillite
La modification la plus importante du droit de la faillite consiste en une abrogation. Selon l’ancien droit, les créanciers de droit public, tels que les administrations fiscales, les assurances sociales ou les autorités percevant des amendes, ne pouvaient pas requérir la faillite d’une société. Ils devaient se limiter à la poursuite par voie de saisie, contrairement aux créanciers privés qui pouvaient demander l’ouverture d’une procédure de faillite. Ce régime particulier offrait une certaine protection aux entreprises confrontées à des difficultés temporaires de trésorerie, notamment en matière de TVA, de cotisations sociales ou d’impôts. Les sociétés concernées pouvaient ainsi bénéficier d’un délai pour régulariser leur situation et mettre en œuvre des mesures d’assainissement avant qu’une faillite ne soit prononcée.
Avec le nouveau droit, cette distinction disparaît et met les créanciers de droit public sur un pied d’égalité avec les créanciers privés, en supprimant les alinéas 1 et 1bis de l’article 43 LP. Désormais, les autorités publiques doivent, comme tout autre créancier, recourir à la procédure de faillite pour le recouvrement de leurs créances à l’encontre des personnes ou entités soumises à la poursuite par voie de faillite (soit les SA, Sàrl, entreprises individuelles, sociétés en nom collectif, coopératives, associations et fondations, selon l’article 39 LP). Concrètement, une dette de TVA, d’AVS ou d’un autre impôt peut désormais justifier une requête de faillite de la part de l’autorité concernée. Cette évolution constitue un changement majeur dans le traitement des dettes publiques. Le processus de recouvrement est en effet facilité pour les autorités publiques, qui peuvent lever les oppositions formées contre les commandements de payer par décision administrative valant mainlevée définitive (art. 80 al. 2 ch. 2 et 5 LP), rendant la procédure plus rapide et potentiellement plus risquée pour les débiteurs.
Une fois la faillite prononcée, les dirigeants peuvent en outre être recherchés personnellement lorsque leur comportement a causé un dommage, notamment s’ils n’ont pas respecté leurs obligations légales en matière de surveillance ou d’annonce du surendettement (art. 754ss CO). Cette responsabilité peut également découler de dispositions spéciales, comme celles relatives aux cotisations sociales impayées (art. 51 LAVS).
En supprimant la protection dont bénéficiaient jusqu’ici les débiteurs à l’égard des créanciers publics, le législateur entend éviter que certaines entreprises ne privilégient systématiquement leurs créanciers privés et ne reportent indéfiniment le paiement de leurs dettes fiscales et sociales.
Le nouveau droit renforce également la coopération entre les autorités en matière de lutte contre les infractions économiques. Selon l’article 11 LP, les offices des faillites sont tenus de signaler systématiquement aux autorités pénales tout crime ou délit poursuivi d’office constaté dans l’exercice de leurs fonctions ou porté à leur connaissance.
Chaque fonctionnaire ou mandataire de l’office est également habilité à dénoncer personnellement les infractions détectées (art. 11 al. 3 LP). Cette obligation vise à améliorer la détection précoce des comportements délictueux liés aux procédures d’insolvabilité et à garantir une application cohérente du droit pénal économique.
Les infractions concernées incluent notamment la gestion déloyale (art. 158 CP), la banqueroute frauduleuse (art. 163 CP), la diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP) ou encore la violation de l’obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP). Ce dispositif vise à renforcer la coordination entre le droit des faillites et le droit pénal, en assurant que les cas de fraude ou de mauvaise gestion soient systématiquement transmis au ministère public.
Autre mesure, lorsqu’une faillite est suspendue faute d’actifs, elle est clôturée si aucun créancier ne requiert la poursuite de la liquidation en versant l’avance de frais exigée par l’office des faillites. Jusqu’en 2025, cette décision de suspension faisait uniquement l’objet d’une publication officielle (art. 230 al. 2 LP). Aujourd’hui, le nouveau droit prévoit que les créanciers connus, notamment ceux ayant fait notifier un commandement de payer, seront informés par courrier de cette décision. Cette mesure vise à renforcer la transparence et à garantir que les créanciers disposent d’une information effective leur permettant, le cas échéant, de poursuivre la procédure par leurs propres moyens.
Enfin, l’office des faillites est expressément autorisé à ouvrir et consulter le courrier adressé au débiteur pendant la procédure de faillite, sauf si le contenu de la correspondance est manifestement dépourvu de pertinence pour le déroulement de celle-ci. Cette mesure vise à faciliter l’identification et la sauvegarde des actifs appartenant à la masse en faillite, ainsi qu’à prévenir la dissimulation de valeurs ou de documents essentiels à la liquidation (art. 222a LP).
C) Modifications du droit pénal
Le nouveau droit élargit le champ d’application de l’interdiction d’exercer une activité prévue à l’article 67 CP. Avant 2025, cette mesure ne concernait que les activités exercées par une personne à titre indépendant, en qualité d’organe, de mandataire ou de représentant d’un tiers. Désormais, elle s’étend à toute fonction devant être inscrite au registre du commerce, incluant les organes de fait. Ainsi, une personne agissant sans titre officiel mais exerçant une influence décisive dans une société peut se voir interdire toute activité similaire et être refusée à l’inscription en tant qu’organe formel.
Afin de garantir l’effectivité de cette mesure, de nouvelles règles de coordination ont été introduites. L’Office fédéral du registre du commerce (OFRC) doit veiller à ce que la base de données centrale des personnes ne contienne aucune inscription incompatible avec une interdiction d’exercer (art. 928a al. 2bis CO). Pour ce faire, les autorités judiciaires pénales cantonales doivent communiquer sans délai leurs décisions à l’OFRC (art. 942 al. 3 CO), qui peut également consulter le casier judiciaire (art. 47 let. e de la Loi fédérale sur le casier judiciaire (LCJ) du 17 juin 2016 (RS 330)). En cas d’incompatibilité constatée, l’OFRC informera l’office cantonal du registre du commerce, lequel doit enjoindre l’entité concernée de prendre les mesures nécessaires (art. 928a al. 2ter et 2quater CO).
VII. Conclusions
- En droit suisse, le créancier n’a pas besoin de posséder un titre (jugement, etc.) pour commencer une procédure de recouvrement de créances. En revanche, un tel titre sera exigé si le débiteur fait opposition au commandement de payer.
- La procédure de recouvrement est indépendante d’une procédure au fond. En effet, en cas d’opposition du débiteur la poursuite est suspendue tant qu’une décision matérielle n’est pas rendue par le tribunal compétent du for judiciaire, qui peut être un tribunal arbitral par exemple.
- La notification d’une réquisition de poursuite permet au créancier de sauvegarder ses droits. En effet, l’envoi d’un tel document interrompt la prescription de la créance et permet au créancier d’être immédiatement informé en cas de faillite du débiteur. En outre, face à un débiteur récalcitrant, elle permet de lever l’opposition immédiatement après l’obtention du jugement final au fond sans avoir à patienter encore de longs mois la notification du commandement de payer et ainsi sans prendre le risque que le débiteur aggrave sa situation financière ou cache ses biens.
- Sauf abus de droit, l’envoi d’une réquisition de poursuite ne porte pas atteinte aux droits de la personnalité du débiteur puisqu’il s’agit d’une mesure expressément autorisée par la loi.
- Une fois la phase préalable terminée, la poursuite continue par voie de saisie ou de faillite, selon que le débiteur est inscrit ou non au Registre du commerce.
- Le système suisse protège à la fois les personnes physiques et morales contre des poursuites injustifiées, mais empêche également les faillites abusives de débiteurs peu scrupuleux.
Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter. M. Lorenzo CROCE a travaillé pour la Chambre commerciale du Tribunal de première instance de Genève et possède une solide expérience dans le domaine des poursuites et des faillites.